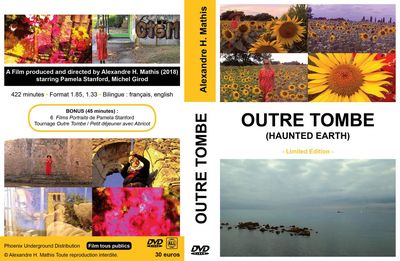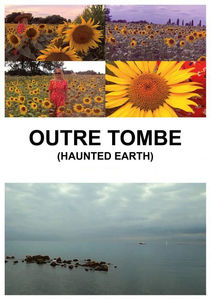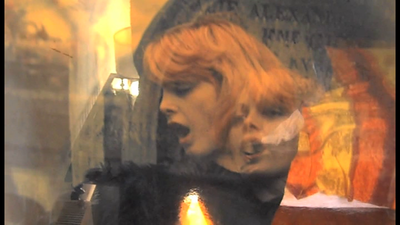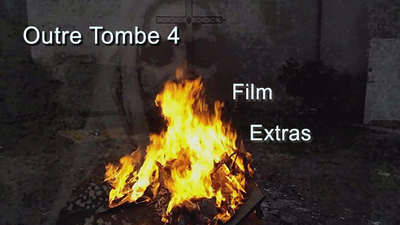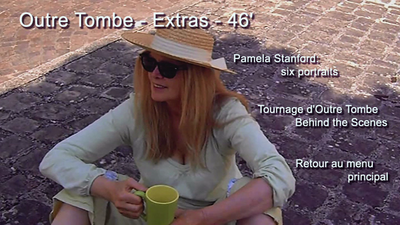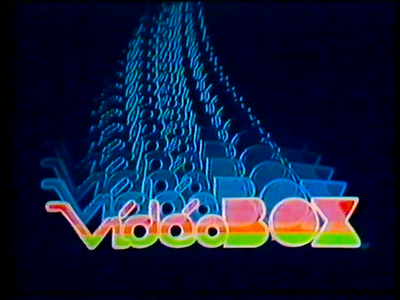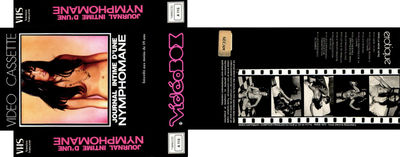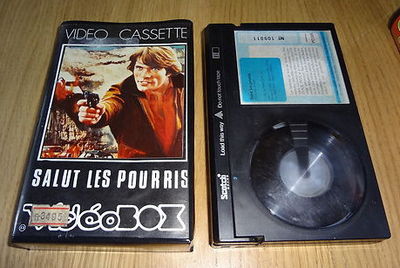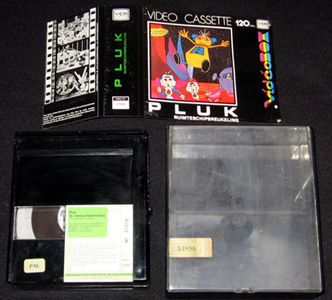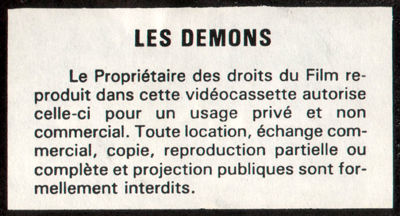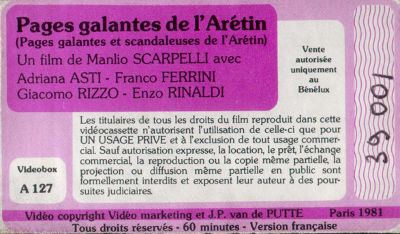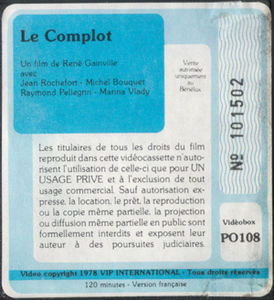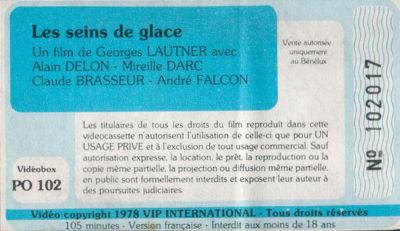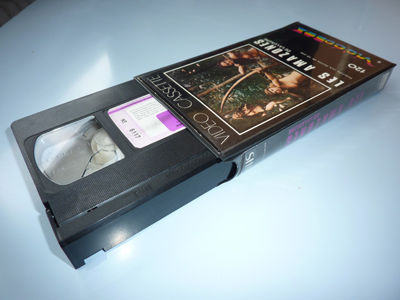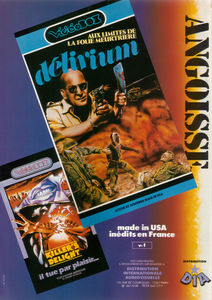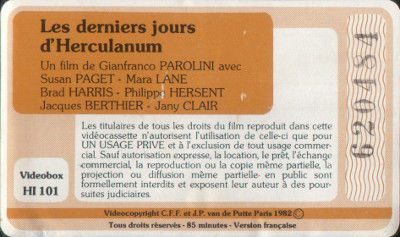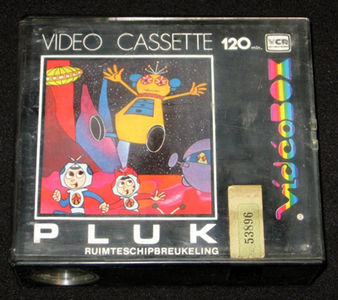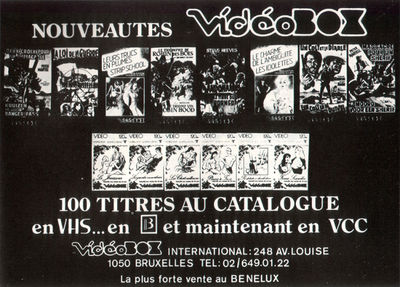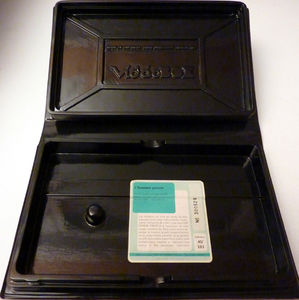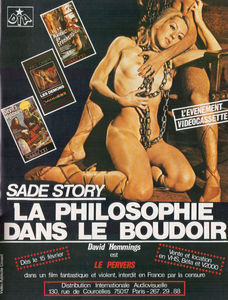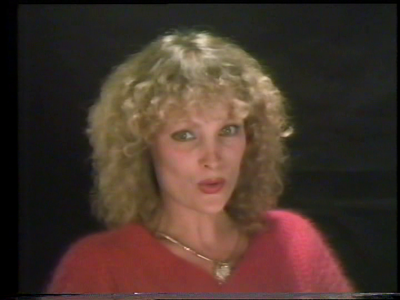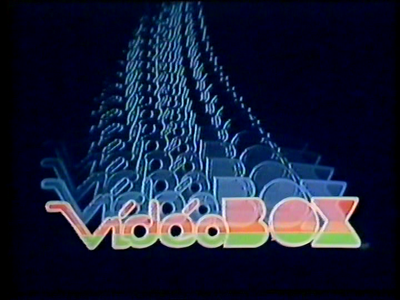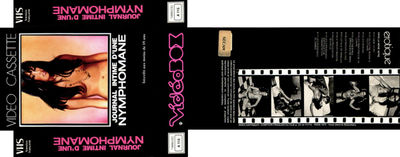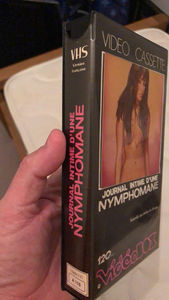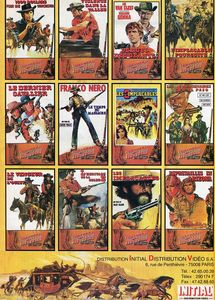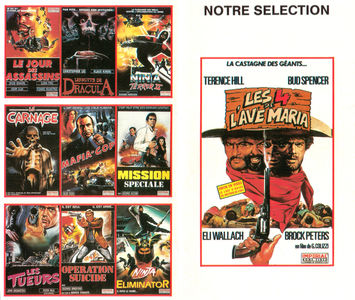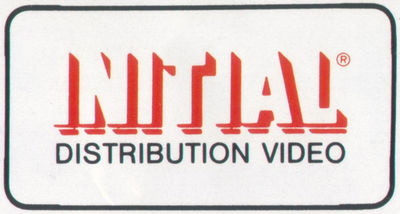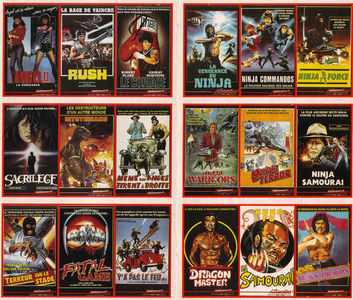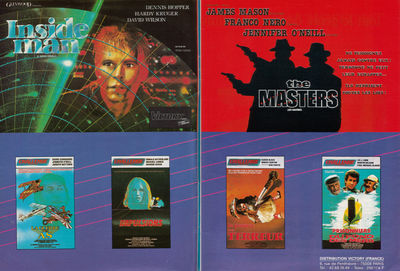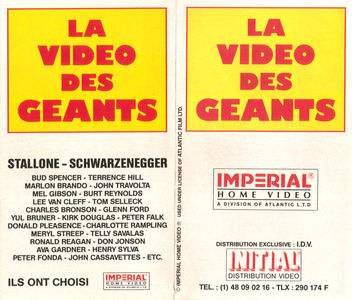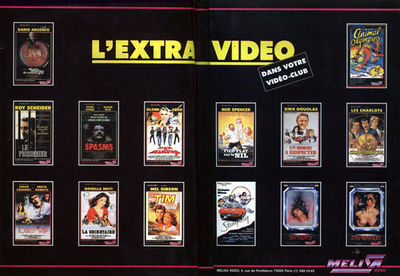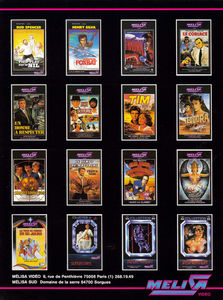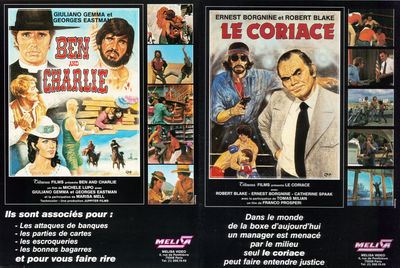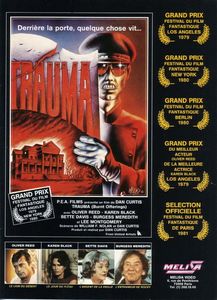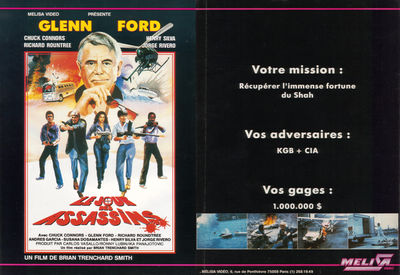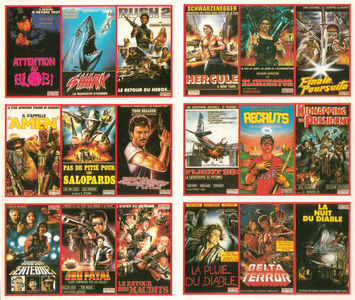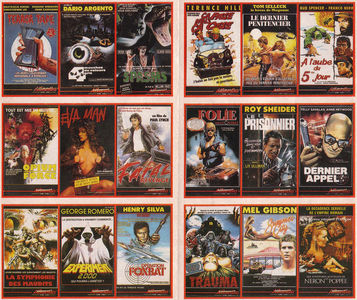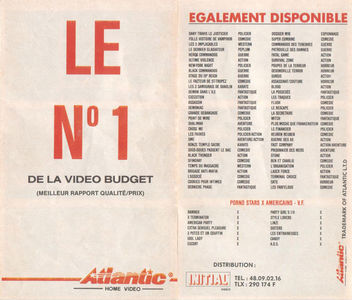Blog créé grâce à Iblogyou. Créer un blog gratuitement en moins de 5 minutes.
-
« Janvier 2026
- L
- M
- M
- J
- V
- S
- D
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- Archives


-
Statistiques
- Articles : 21
- Commentaires : 3
-
Outre Tombe Publié le Dimanche 5 Janvier 2020 à 00:23:28Ecrire un commentaire - Permalien -
 INITIAL IMG Publié le Mercredi 1 Juillet 2020 à 17:58:31Gillox Publié le Dimanche 5 Juillet 2020 à 14:49:13
INITIAL IMG Publié le Mercredi 1 Juillet 2020 à 17:58:31Gillox Publié le Dimanche 5 Juillet 2020 à 14:49:13
Copyright www.iblogyou.fr 2005-2026 - Signaler un abus sur ce blog